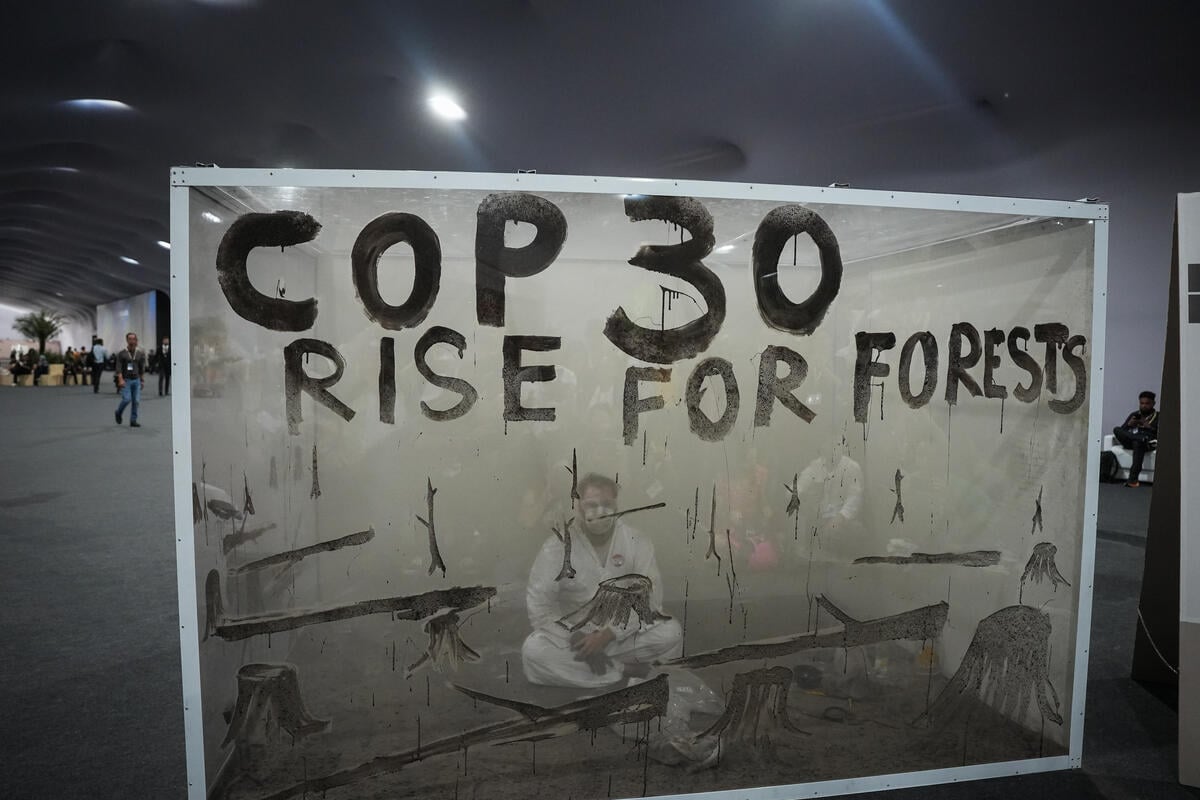Alors que la protection des océans s’impose peu à peu dans les priorités internationales, une autre réalité, plus inquiétante, se joue en silence sous la surface : l’exploitation minière des grands fonds marins. Encore méconnue du grand public, cette industrie émergente menace des écosystèmes d’une rare fragilité. Face à ce risque, l’Afrique ne peut rester spectatrice. Elle doit se positionner clairement contre ce nouveau front de l’extractivisme et faire entendre sa voix dans les négociations internationales.
Ces dernières années, les appels à protéger la haute mer se sont multipliés. Les conférences s’enchaînent, les traités se négocient, les engagements s’affichent. Mais pendant ce temps, une autre dynamique se déploie, loin des regards et des radars médiatiques: celle de l’exploitation minière en eau profonde. Il ne s’agit pas ici d’un simple débat technique ou d’une alerte réservée aux écologistes. Ce qui se prépare dans les abysses concerne directement l’avenir de la planète et celui du continent africain.
Une menace invisible, mais bien réelle
L’exploitation minière des grands fonds consiste à extraire des métaux rares comme le cobalt, le nickel et le manganèse sous forme de nodules polymétalliques présents sur le plancher océanique. Elle mobilise des engins massifs, capables de labourer les fonds marins à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Le problème? Ces zones abritent une biodiversité unique, largement inexplorée et d’une extrême fragilité. Les impacts sont potentiellement irréversibles: destruction d’habitats, extinction d’espèces, perturbation du climat et des chaînes alimentaires océaniques.
Et cela, bien avant que les promesses économiques de cette industrie ne se concrétisent – si tant est qu’elles le fassent un jour. Car en l’état, rien ne garantit que les bénéfices iront aux populations locales ou serviront un quelconque développement durable.
Il est urgent de rappeler quelques vérités simples mais fondamentales: les océans produisent 50 % de l’oxygène que nous respirons, absorbent 25 % des émissions mondiales de CO₂, et capturent 90 % de la chaleur excédentaire liée à ces émissions. Autrement dit, ils sont notre premier bouclier face au changement climatique. Les déstabiliser, c’est creuser notre propre tombe.
Un débat global, une voix africaine indispensable
La récente Conférence des Nations Unies sur l’océan, tenue à Nice, a vu plusieurs États ratifier le Traité sur la haute mer, un texte destiné à renforcer la gouvernance des zones marines au-delà des juridictions nationales. Les pays africains ont tout intérêt à soutenir cette dynamique. Mais ils doivent aller plus loin.
L’Accord BBNJ, qui découle de ce traité, vise à assurer la conservation de la biodiversité marine. En parallèle, l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) est censée réguler les activités minières dans ces zones. Ces deux cadres sont aujourd’hui à la croisée des chemins : soit ils deviennent des outils cohérents de protection, soit ils se transforment en cautions techniques d’une industrie destructrice.
Il est illusoire de croire que l’on peut protéger les océans tout en autorisant leur exploitation industrielle des fonds marins. Il faut choisir. Et ce choix, l’Afrique ne peut le déléguer à d’autres.
Une responsabilité historique
Sur tout le continent, des millions de personnes vivent des ressources marines. Pêche artisanale, tourisme côtier, activités économiques locales : les océans nourrissent, protègent, et soutiennent des vies. Ils le font sans bruit, sans condition. Le minimum, aujourd’hui, serait de leur accorder en retour la protection qu’ils méritent.
Dire non à l’exploitation minière des grands fonds n’est pas un refus du progrès. C’est une affirmation de responsabilité. C’est reconnaître que le progrès ne vaut que s’il est durable, équitable et respectueux du vivant. L’Afrique a le droit et le devoir de promouvoir un modèle de développement durable qui ne sacrifie pas les écosystèmes au nom du profit immédiat.
Exiger un moratoire mondial, maintenant
Face à l’urgence écologique et au manque de connaissances sur les conséquences à long terme de cette industrie, un moratoire mondial s’impose. Le temps d’évaluer les risques, de renforcer la recherche scientifique, et surtout, d’ouvrir un véritable débat démocratique sur les choix que nous voulons faire.
L’Afrique ne peut se permettre de rester en marge de ce débat. Elle doit se positionner avec clarté, exiger un moratoire immédiat sur l’exploitation minière des grands fonds, et s’engager pour la préservation d’un bien commun qui conditionne l’avenir de toute l’humanité.Ne rien faire, c’est accepter l’irréparable. Prendre position, c’est défendre la vie. Il est temps d’agir.