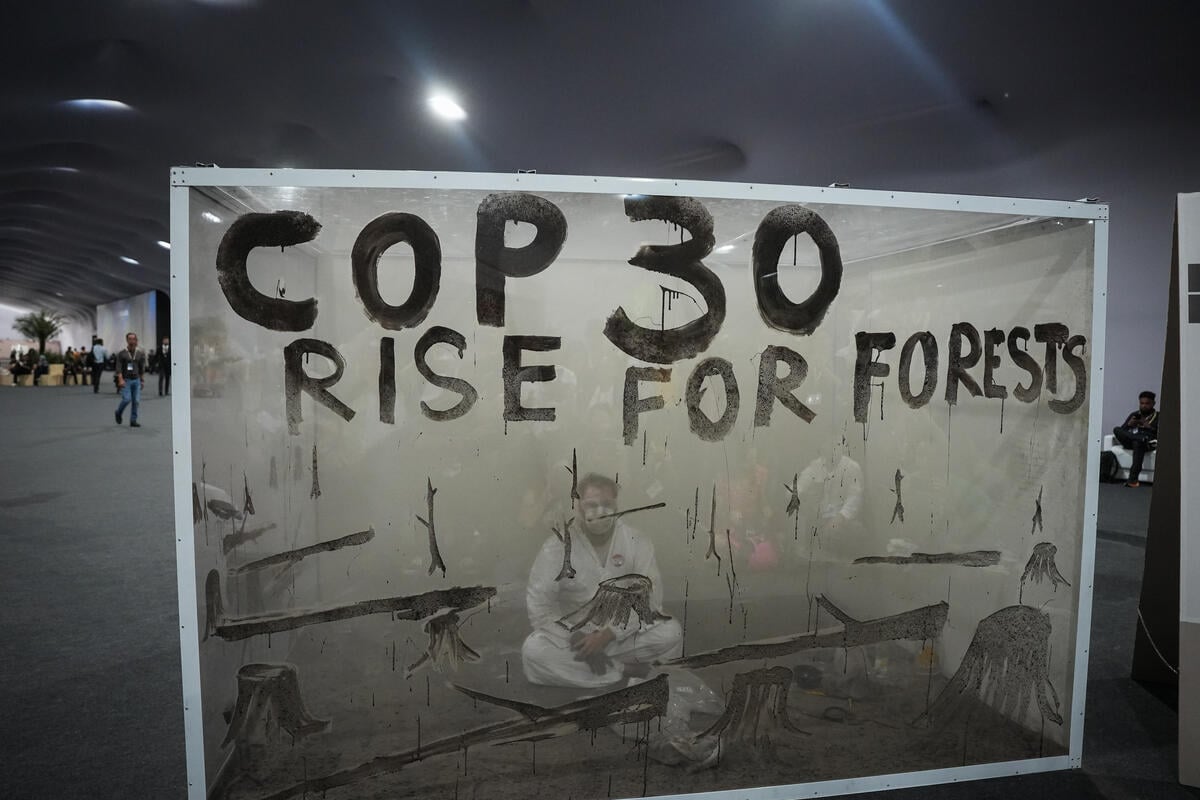Pendant des années, la société civile et les communautés côtières ont réclamé la fin des subventions qui alimentent la surpêche et la destruction des océans.
Le 15 septembre 2025, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a franchi une étape historique : l’Accord sur les subventions à la pêche est enfin entré en vigueur.
C’est le premier instrument mondial juridiquement contraignant visant à limiter les milliards de dollars de subventions néfastes qui vident nos mers et fragilisent les moyens de subsistance des populations.
Pourquoi cet accord est essentiel et pourquoi maintenant.
Partout dans le monde, l’argent public continue de financer des flottes industrielles qui pêchent plus loin, plus longtemps, et plus profondément que ce que l’océan peut supporter.
Chaque année, plus de 35 milliards USD de subventions sont versés au secteur de la pêche dont près des deux tiers encouragent la surpêche.
Les conséquences sont dramatiques. Un tiers des stocks mondiaux de poissons est déjà surexploité, tandis que les écosystèmes côtiers s’effondrent sous le poids combiné du changement climatique, de la pollution et de la pression industrielle.
Partout sur le continent, les pêcheurs artisanaux d’Afrique, véritables gardiens de la mer, peinent à rivaliser avec des flottes étrangères massivement subventionnées et suréquipées.
L’entrée en vigueur de cet accord reconnaît une vérité simple : on ne peut pas protéger l’océan tout en payant pour sa destruction.
Ce que prévoit l’Accord sur les subventions à la pêche.
L’accord interdit trois formes de subventions parmi les plus destructrices :
- La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) : aucun État ne peut subventionner un navire ou un opérateur pris en infraction.
- La pêche sur des stocks surexploités : les subventions sont interdites lorsque les ressources ciblées sont déjà en état de surexploitation.
- La pêche en haute mer non réglementée : il est désormais illégal de financer la pêche dans les zones dépourvues d’un système de gestion.
L’accord introduit aussi des règles de transparence : les États devront déclarer publiquement le montant, la destination et la nature de leurs subventions.
Les pays en développement bénéficieront d’un délai d’adaptation et d’un fonds spécial pour les accompagner dans la transition vers une pêche durable.
Ce n’est qu’un début : les négociations doivent se poursuivre sur d’autres types de subventions, notamment celles liées au carburant ou à la construction de navires.
Mais c’est une avancée majeure vers plus d’équité et de durabilité.
Ce que cela signifie pour les communautés côtières africaines.
En Afrique, la pêche n’est pas qu’un métier : c’est une culture, un socle et un moyen de survie.
De Saint-Louis à Bissau, de Nouadhibou à Cape Town, des millions de familles vivent de la mer.
Pourtant, des flottes industrielles, souvent étrangères, accaparent les ressources au détriment des pêcheurs artisanaux.
En limitant les subventions néfastes, l’accord offre une véritable opportunité de redressement. Il permettra le rétablissement des stocks halieutiques, garantissant ainsi la sécurité alimentaire à long terme.
Il contribuera à rétablir une concurrence plus équitable entre pêche artisanale et pêche industrielle, tout en renforçant la transparence et la redevabilité dans l’utilisation de l’argent public.
Surtout, il protégera les moyens de subsistance des communautés côtières — en particulier ceux des femmes transformatrices et des jeunes actifs tout au long de la chaîne de valeur.Un océan en bonne santé, c’est non seulement une victoire écologique, mais aussi une garantie de dignité et de justice sociale.
Jusqu’à 20 % des prises illégales mondiales viendraient des eaux Ouest Africaine, et le coût économique pour nos pays dépasse les 2 milliards de dollars par an.
C’est pourquoi cet accord compte autant : il ne s’agit pas seulement de sauver les poissons, mais de restaurer la justice et la dignité de celles et ceux qui vivent de la mer.
Et maintenant ?
L’entrée en vigueur de l’accord est une victoire, mais sa réussite dépendra de sa mise en œuvre effective.
Les gouvernements doivent rapidement ratifier, appliquer et rendre publiques leurs données.
La société civile et les citoyens devront surveiller, dénoncer et exiger des comptes.
Si les États respectent leurs engagements, cet accord pourrait marquer le début d’une ère nouvelle : celle d’océans vivants, de communautés prospères et de politiques publiques enfin cohérentes avec la durabilité.
C’est le moment de transformer cette promesse en réalité, pour nos océans et pour toutes les vies qu’ils nourrissent.

Aliou Ba
Responsable de la campagne Océan, Greenpeace Afrique