
Sommaire

Edito
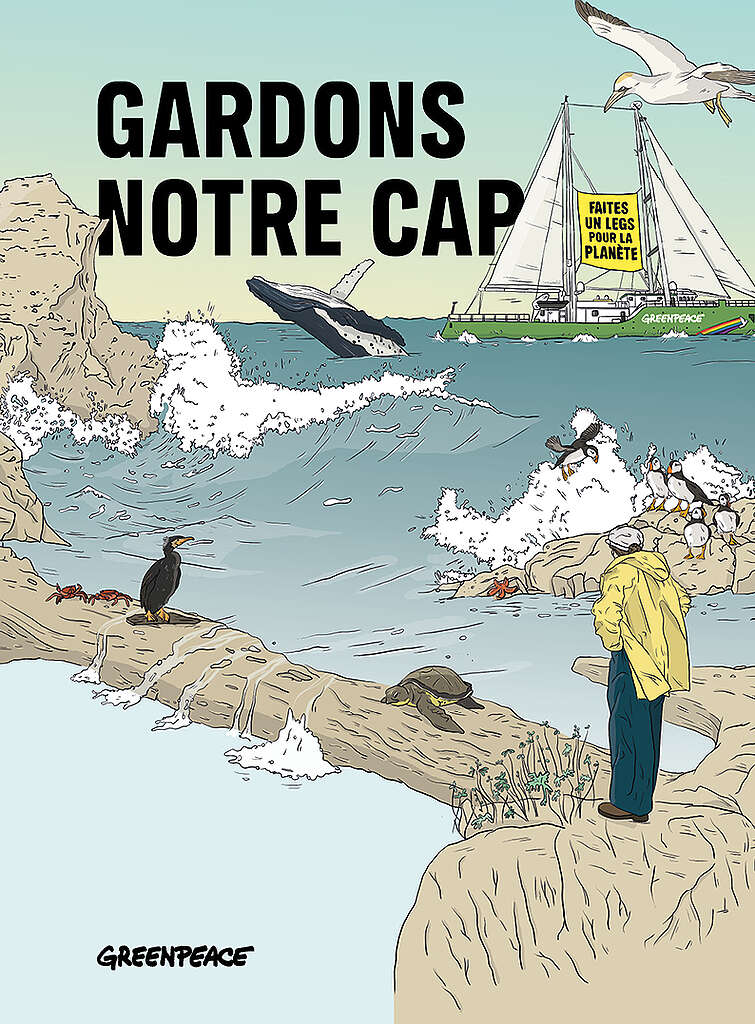
Hinterlassen Sie etwas Bleibendes auf dieser Welt

Un voyage tout en lenteur

On ne coule pas un arc-en-ciel
Une nouvelle ère pour la justice climatique
Vous aussi, vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi servaient l’accord de Paris et les négociations internationales sur le climat. À quoi bon les COP à répétition, les promesses non tenues, les rapports d’experts ignorés ?
Parfois, face à l’inaction de nos gouvernements, on doute. Et pourtant, les choses avancent. Lentement, parfois trop, mais chacune de nos mobilisations comptent et peut mener à d’importantes victoires.
Le 23 juillet 2025, à La Haye, j’ai assisté à ce qui restera sans doute comme l’un des tournants les plus prometteurs de la décennie en matière de climat et de droits humains. Ce jour-là, la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif sur les obligations des États face au changement climatique. Un moment historique.
Pour la première fois, la plus haute juridiction des Nations Unies a affirmé que les États ont des obligations juridiques : réduire leurs émissions pour respecter l’objectif des 1,5 °C, protéger les droits humains menacés par le dérèglement climatique, y compris pour les générations futures. Pour la première fois, la justice dit ce que la société civile clame depuis des années : l’inaction climatique est une injustice, et elle peut avoir des conséquences juridiques. L’action n’est plus une option mais un devoir.
Cet avis est aussi le fruit d’une mobilisation citoyenne exceptionnelle, portée notamment par la jeunesse du Pacifique et du monde entier. Il représente bien plus qu’un texte juridique : c’est un souffle d’espoir, un précieux outil entre les mains de celles et ceux qui luttent pour leur survie, et de celles et ceux qui croient encore en la justice, comme vous et moi.
Altynaï Bidaubayle
Hinterlassen Sie etwas Bleibendes auf dieser Welt
Vererben heißt weitergeben, nach dem eigenen Tod, das gesamte oder einen Teil des Vermögens per Testament einer Person oder einer Organisation wie Greenpeace zu hinterlassen. Die Symbolkraft dieses Schritts ist groß und seine Wirkung ebenfalls! Jede Person, die Greenpeace Luxemburg in ihr Testament aufnimmt, überträgt uns damit eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt: im eigenen Andenken für den Schutz unseres Planeten zu handeln und den Ursachen des Klimawandels entgegenzuwirken.
Nach luxemburgischem Recht können Sie grundsätzlich frei über Ihr gesamtes Vermögen verfügen. Es gibt lediglich eine Einschränkung: den sogenannten Pflichtteil, der automatisch an Ihre direkten Nachkommen, also Kinder oder Enkel, geht. Vermächtnisse zugunsten gemeinnütziger Organisationen, darunter auch die Stiftung Greenpeace Luxemburg, profitieren von einer ermäßigten Erbschaftssteuer, die pauschal auf 4 % festgelegt ist.
Es ist auch möglich, schon zu Lebzeiten einen Teil seines Vermögens in Form einer Schenkung zu „vererben“. Dabei handelt es sich um einen notariell beglaubigten Akt, bei dem der oder die Schenkende einen oder mehrere Vermögenswerte unentgeltlich an eine begünstigte Person oder Organisation überträgt. Es handelt sich um ein Geschenk ohne Gegenleistung.
Mit einer Lebensversicherung wiederum lässt sich ein Kapital aufbauen, das im Todesfall oder auch zu Lebzeiten an eine frei gewählte Person oder Organisation übertragen werden kann. Dabei handelt es sich um einen Sparvertrag mit einem Versicherer, der die Zahlung eines Kapitals oder einer Rente zu einem festgelegten Zeitpunkt vorsieht.
Möchten Sie mehr erfahren? Wenden Sie sich gerne direkt an mich. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie individuell zu beraten.
Marie-Héloïse Adrien
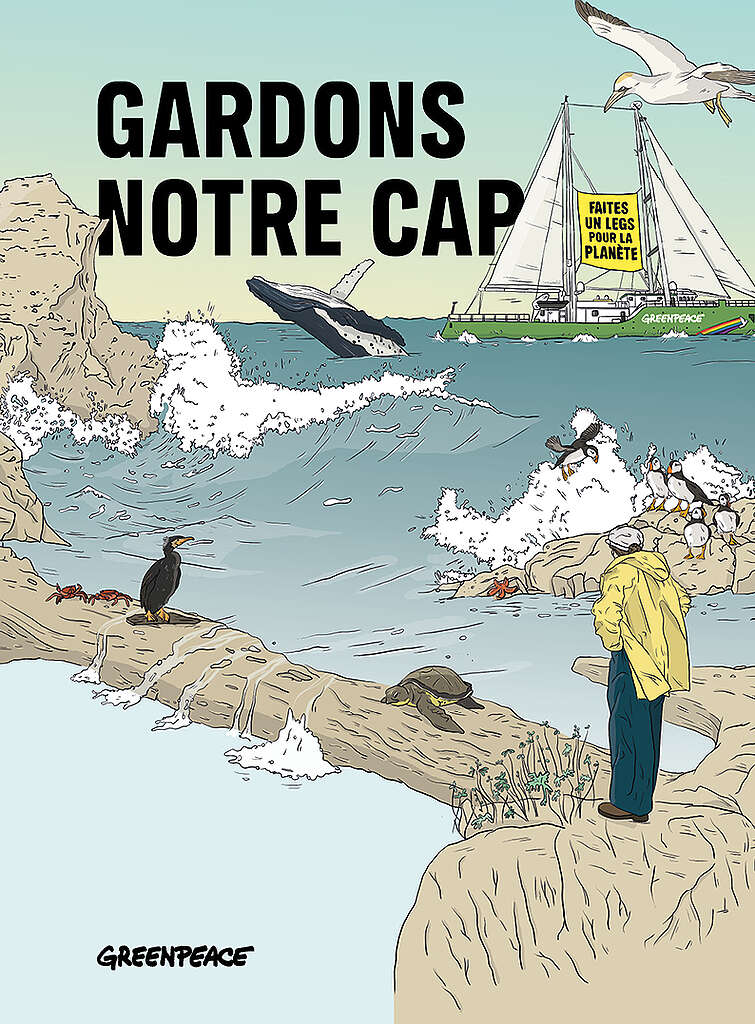
Un voyage tout en lenteur, riche de découvertes

Cette année, pour les vacances, Anaëlle, jeune étudiante belge, a décidé de voyager à vélo avec sa famille. Retour sur des vacances écolo et inoubliables.
La fin de l’été est proche. Probablement avez-vous déjà, vous aussi, repris le chemin de l’école ou du travail, avec des souvenirs estivaux plein la tête. Avec ma famille, nous avons choisi, cette année, de partir à vélo.
Pourquoi partir à vélo ?
Depuis la crise sanitaire du COVID-19, les adeptes du cyclotourisme sont de plus en plus nombreux. Notre famille ne fait pas exception, puisque notre premier voyage à vélo a eu lieu en 2021 aux Pays-Bas. À l’époque, le choix de partir à vélo avait été dicté par notre volonté de ne pas devoir réserver quoi que ce soit pour nos vacances. Nous craignions trop l’annonce d’un confinement de dernière minute. Fin avril 2025, nous avons réitéré l’expérience pendant trois jours en Belgique, dans la province du Limbourg, ce qui nous a confortés dans l’idée de repartir pour un périple de 15 jours cet été.
Le périple et son organisation
Nous aimons bouger, mais nous ne sommes toutefois pas des sportifs et sportives de haut niveau. C’est pourquoi le critère principal pour le choix de notre itinéraire est le dénivelé. Comme le laisse deviner les destinations de nos précédents périples (Pays-Bas, Flandre), nous préférons les itinéraires assez plats. C’est pour cela qu’il nous paraissait important de choisir un parcours se trouvant le long de cours d’eau. Il fallait ensuite trouver un itinéraire accessible en train sans trop de difficultés, puisque l’idée était de ne pas prendre la voiture. Nous avions entendu parler de la Voie bleue, qui part de la frontière luxembourgeoise et permet d’aller jusqu’à Lyon, en longeant la Moselle, le canal des Vosges et la Saône. Afin de réduire la distance, nous avons décidé de démarrer notre périple directement à Nancy. La première partie de nos vacances consistait donc à faire Nancy-Lyon, majoritairement via la Voie bleue. Au sixième jour de notre voyage, nous l’avons quittée pour rejoindre Dijon, puis prendre la Voie des vignes. Elle présente plus de dénivelé que la Voie bleue mais vaut vraiment le coup. On pédale sur des petites routes à travers les vignes, en passant dans différents petits villages, et devant de nombreux châteaux. Pour les gastronomes, ce parcours est aussi l’occasion de faire quelques dégustations viticoles.
Après 10 jours et environ 600 kilomètres, nous avons atteint la Ville des Lumières. Après avoir pris le temps de déambuler dans ses ruelles, il a fallu organiser un retour vers le Nord… afin d’être au travail dans les temps. Nous avons alors alterné les moyens de transport, entre le train et le vélo, en longeant la Loire. Au fin fond de la campagne française, nous avons vécu quelques moments épiques avec les TER, loin d’être conçus pour accueillir 4 vélos bien chargés, sans parler des gares équipées d’ascenseurs bien trop petits pour des vélos d’adultes ! Au cours de notre périple, nous avons donc serpenté le long des rivières et des canaux, des vignes et des champs. Nous avons découvert des villes et des villages dans lesquels nous ne nous serions jamais arrêté·es autrement, qui se sont révélés être de petites pépites. Bayon, Corre, Soing, Heuilley-sur-Saone, Meursault, Tournus, Marcigny, Liverdun… autant de lieux qui, il y a 3 mois à peine, m’étaient totalement inconnus. Les pistes cyclables étaient essentiellement en bitume, même s’il arrivait parfois qu’elles se transforment en chemins, parfois en terre battue, parfois en plus mauvais état. Ces chemins en mauvais état peuvent d’ailleurs se révéler traîtres, puisque l’un d’eux entraina ma chute. Elle fut assez violente, les cailloux ayant perforé mon casque (ce qui montre l’importance d’en avoir un !) mais elle eut l’avantage de me faire oublier mon mal au derrière pour la journée !
Bouger et se déconnecter
Si je devais mettre en avant un bienfait du voyage à vélo, c’est bien qu’il permet de déconnecter. Après une année chargée, passer 15 jours sur le vélo permet de bien décompresser, surtout que je ne pense généralement à rien quand je pédale. Pas de meilleur moyen pour se vider la tête !
C’est aussi une bonne manière de prendre l’air. Afin de ne pas subir la contrainte de distances quotidiennes prédéfinies et de rester libres, nous avions choisi de dormir en tente, nous avons donc été en permanence dehors pendant 15 jours. Après une année passée derrière un bureau et sur les bancs de l’université, ça fait beaucoup de bien. Il faut reconnaître que dormir en tente n’est pas forcément la manière la plus confortable de passer la nuit, mais ce n’est pas pour autant une expérience désagréable. Ça permet par exemple de s’endormir au son des grenouilles ou encore d’être réveillé par une chouette hulotte au beau milieu de la nuit !
Finalement, je suis rentrée de ces vacances avec des souvenirs plein la tête et un grand sentiment de fierté ! J’ai parcouru 870 km sans avoir recours ni à l’avion ni à la voiture, preuve qu’il est possible de s’évader tout en respectant notre planète !
Anaëlle Gonon
Loi Duplomb :
polémique en France, interrogations au Luxembourg

Adoptée début juillet en France, la loi Duplomb a suscité une vague de contestation massive et inédite. En cause, la réintroduction de l’acétamipride, un pesticide controversé. Une situation qui soulève inévitablement des questions de ce côté de la frontière : qu’en est-il du Luxembourg ? Et où en est le pays dans sa lutte contre les pesticides ?
Le 8 juillet dernier, l’Assemblée nationale française adoptait la loi Duplomb, censée répondre aux difficultés des agriculteurs et agricultrices. Cette loi a suscité une forte contestation, en particulier suite à la réintroduction encadrée de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Interdit en France depuis 2018, il est soupçonné d’avoir des effets dévastateurs sur les pollinisateurs, notamment les abeilles.
La réaction citoyenne ne s’est pas fait attendre. Moins de 48 heures après le vote, une pétition appelant à l’abrogation du texte était mise en ligne. Elle a très rapidement franchi le million de signatures, avant de dépasser les deux millions fin juillet. Une mobilisation exceptionnelle à laquelle Greenpeace France s’est immédiatement associée, dénonçant un recul environnemental majeur.
Ce débat dépasse toutefois largement les frontières françaises. Car si l’acétamipride restera finalement interdit en France après une décision du Conseil constitutionnel, il est autorisé dans toute l’Union européenne jusqu’en 2033. Cette situation, dénoncée par le monde agricole, révèle les failles d’une politique européenne fragmentée, où chaque pays applique ses propres règles en matière de pesticides.
Et au Luxembourg ?
Malheureusement, l’acétamipride est bel et bien utilisé. Selon natur&ëmwelt, entre 50 et 60kg de cet insecticide sont épandus chaque année, principalement sur des cultures telles que le colza ou les pommes de terre. Même si ces quantités restent limitées, leur impact sur la biodiversité locale alimente de vives inquiétudes. Des observations récentes font état d’un déclin progressif des pollinisateurs sauvages, en partie attribuable à ces substances.
Pourtant, le pays a adopté, dès 2017, un Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques, visant une baisse de 50 % d’ici 2030. Des mesures concrètes ont été introduites, comme le retrait de nombreux pesticides de la vente libre, l’obligation de formation pour les usages professionnels, ou encore l’interdiction de pulvérisation sur les surfaces imperméables reliées aux réseaux d’eau.
Toutefois, les résultats sont loin d’être à la hauteur. Des résidus de pesticides restent présents dans de nombreux fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle, et l’acétamipride n’est qu’un exemple parmi d’autres produits préoccupants encore utilisés. Malgré les ambitions affichées, la transition vers un modèle agricole plus respectueux du vivant progresse bien trop lentement.
Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire d’accélérer la sortie des pesticides néfastes, d’accompagner sérieusement les agriculteurs et agricultrices dans cette évolution, et de soutenir massivement les pratiques biologiques. La mobilisation française le démontre : les citoyens et citoyennes attendent des actes forts pour préserver la biodiversité, la santé publique et nos écosystèmes.
Gauthier Hansel

On ne coule pas un arc-en-ciel
Au matin du 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior gît au fond du port d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, la coque déchirée par deux bombes. Fernando Pereira, photographe, trouve la mort dans cet attentat perpétré par les services secrets français. Il avait 35 ans.
Il y a 40 ans, le premier Rainbow Warrior, qui prévoyait de se rendre en Polynésie française, dévie sa trajectoire afin d’aider à l’évacuation d’un atoll des Îles Marshall, contaminé par des essais nucléaires américains.
Entre 1946 et 1958, les États-Unis ont mené 67 essais nucléaires dans ces îles, avec des conséquences dramatiques pour les populations et l’environnement : contamination radioactive des sols, des eaux, et de la nourriture.
Après cette évacuation de grande ampleur, qui durera 11 jours, le Rainbow Warrior reprend sa route vers Auckland afin de se ravitailler avant sa prochaine mission : s’opposer aux essais nucléaires d’une autre puissance coloniale, la France.
Il ne quittera pas le port.
L’enquête qui suit expose la complicité directe de l’État français. Sous la pression internationale, le gouvernement est forcé de reconnaître sa responsabilité : le bateau a bien été coulé par les services secrets français, probablement sur ordre du président Mitterrand. L’incident diplomatique conduit à la démission du ministre de la Défense.
Cet attentat n’était pas un simple sabotage. Il visait à « neutraliser » le Rainbow Warrior et mettre fin aux manifestations de Greenpeace. 40 ans après, la répression persiste. Qu’elles soient physiques, judiciaires, politiques ou médiatiques, ces attaques traduisent une volonté manifeste de faire taire toutes celles et ceux qui dénoncent les dérives d’un modèle fondé sur l’exploitation et la destruction.
Cet épisode dramatique du
Rainbow Warrior a marqué un tournant. Ce qui devait nous faire taire nous a, au contraire, rassemblé·es. Aujourd’hui des milliers de personnes ont rejoint notre lutte et Greenpeace est devenue un mouvement mondial, porté par l’espoir, l’action et la résistance.
Corinne Leverrier


